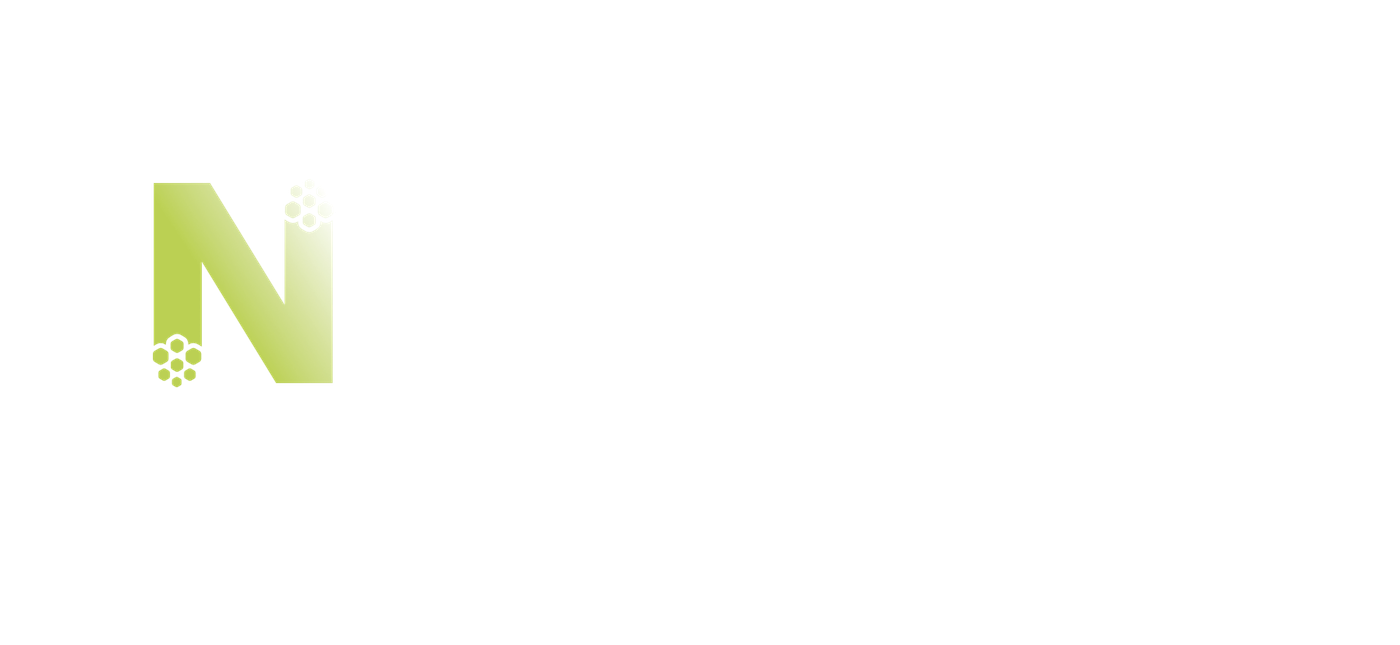Fixation d'azote et minéralisation : les moteurs naturels de la fertilité des sols
L'azote est présent dans la nature sous plusieurs formes : gazeuse, minérale et organique. Les sols fertiles contiennent beaucoup d'azote sous forme organique, plus qu'il n'en faut pour la nutrition des cultures. Cependant, cet azote n'est pas immédiatement disponible pour les plantes, il doit d'abord être transformé en azote minéral pour devenir un nutriment. C'est grâce à des processus biologiques que des micro-organismes transforment l’azote organique en azote minéral assimilable par les cultures. Ainsi, dans le sol l'azote subit de nombreuses transformations, passant d'une forme à une autre à mesure que les organismes l'utilisent.
De l'air au sol : la fixation biologique de l'azote
L’azote gazeux présent dans l'atmosphère - diazote N2 - peut être transformé en azote minéral directement disponible pour les plantes, on parle alors de la fixation biologique de l’azote. Ce processus permet de fixer entre 139 et 170 millions de tonnes d’azote atmosphérique par an. Il est effectué par des bactéries fixatrices d'azote, capables de réduire le diazote N2 en ammoniac NH3. La particularité c'est que dans la molécule de diazote atmosphérique (N2) les deux atomes d'azote(N) sont liés par une triple liaison très stable et difficile à rompre. La réaction doit donc être catalysée par une enzyme, la nitrogénase, présente uniquement dans certaines bactéries.
Cette enzyme est capable de casser la triple liaison, mais elle est très sensible à l’oxygène et ne peut pas fonctionner en sa présence. Les bactéries ont alors développé, avec le temps, différentes stratégies pour éviter d’exposer la nitrogénase à l’oxygène. La première stratégie, est la formation de structures isolant totalement l'enzyme de l'air, et formant une "chambre" en environnement contrôlé pour que la fixation de l'azote se produise. C’est la stratégie qu’utilisent par exemple les bactéries du genre
Rhizobium. Elles s'associent en symbiose avec des légumineuses et se localisent généralement dans des formations spécifiques, les nodosités situées sur les racines. Ainsi, la plante crée un environnement favorable aux bactéries dans sa rhizosphère en leur mettant à disposition une grande quantité d'énergie issue de la photosynthèse et, en échange, elle récupère les composés azotés minéraux produits dans les
nodosité par les bactéries . Une seconde stratégie consiste à fixer de l'azote la nuit, certaines bactéries fixatrices photosynthétiques (non symbiotiques) utilisent cette stratégie. En effet, lorsque la photosynthèse est en pause et qu'elle ne produit plus d'oxygène, la nitrogénase peut fonctionner à nouveau.
La nature a donc trouvé deux stratégies pour isoler la nitrogénase de l’oxygène : soit par un déphasage dans l’espace (cellules spécialisées et formation de tissus isolants), soit par un déphasage dans le temps (jour/nuit). Dans les deux cas, les plantes impliquées ont accès à une source supplémentaire d'azote, et dépendent donc moins de la disponibilité d'azote minéral présent dans le sol. Une fois que l'azote atmosphérique est fixé sous forme organique, il nourrit l'écosystème du sol, et s'accumule progressivement dans la matière organique du sol constituées de débris végétaux, insectes et biomasse bactérienne.
Comment l’ammonification façonne-t-elle la fertilité des sols ?
L'ammonification est le processus naturel qui transforme l'azote contenu dans la matière organique pour produire de l'azote minéral grâce à l'action de micro-organismes.
Dans un premier temps, des bactéries ammonifiantes décomposent la matière organique sous formes de protéines puis d'acides aminés. Elles possèdent une enzyme, l’hydrogénase, qui transforme ces acides aminés en ammoniac, dissous dans l'eau du sol sous forme d'ions ammonium. Beaucoup d'espèces de bactéries peuvent effectuer cette phase d’ammonification, ce qui la rend beaucoup moins dépendante des paramètres environnementaux que la fixation biologie de l'azote. Si, suite à une perturbation de l’environnement, une espèce de bactérie ne peut plus ne peut plus accomplir sa tâche, une autre espèce moins sensible peut prendre la relève.
L'ammonification est donc l'étape décisive qui détermine la disponibilité de l'azote minéral dans le sol.

Favoriser ces processus pour adapter l’utilisation d’engrais azotés
La minéralisation de la matière organique du sol est régie par plusieurs facteurs. Elle est favorisée par une température entre 20 et 30°C et une humidité du sol comprise entre 50 et 70%. Les autres facteurs sont liés aux pratiques agricoles ainsi qu'au type de sol et son pH. En effet, pour permettre aux bactéries de respirer, la porosité est un paramètre très important. Il est donc primordial de ne pas tasser le sol. De plus, sur sols acides, des apports réguliers de chaux sont nécessaires afin d'assurer un pH neutre, indispensable pour garantir un optimum de croissance aux microorganismes. Ce processus est essentiel car, chaque année, 2 à 5% du pool d'azote organique du sol est minéralisé, ce qui représente une part conséquente de l'azote utilisé par les plantes.
Ensuite, afin de tirer au mieux profit de la fixation biologique de l'azote gazeux, il est recommandé de cultiver des légumineuses en tant que cultures intermédiaires ou même les intégrer comme cultures annuelles dans la rotation culturale. étant donné qu'elles ne nécessitent pas d'apport azoté et qu'elles fixent l'azote atmosphérique dans le sol, les apports en engrais pour la culture suivante peuvent être réduits, tout comme la consommation annuelle d'azote.
Ces sources d'azotes non-négligeables sont donc importantes à comprendre pour pouvoir adapter et réduire au maximum ses apports d’engrais azotés de synthèse. Il est donc recommandé d'effectuer des
analyses de sol
ainsi qu'un bilan azoté afin de mieux piloter son programme de fertilisation.
Références :
- Bernhard A., 2010. The Nitrogen Cycle: Processes, Players, and Human Impact [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.fulweilerlab.com/uploads/3/7/6/7/3767379/the_nitrogen_cycle__processes_players_and_human_impact___learn_science_at_scitable.pdf
- B.PEOPLES M., T.CRASWELL E., 1992. Biological nitrogen fixation: Investments, expectations and actual contributions to agriculture [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://link.springer.com/article/10.1007/BF00011308
- CANNAVO P., COMIFER, 2019. Quels paramètres influencent la minéralisation de l’azote dans les substrats de culture organiques hors-sol ? [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://ancien.comifer.asso.fr/images/rencontres/14emes_rencontres2019/Oraux/Cannavo/R19-PRESENTATION-CANNAVO.pdf
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOIRE, 2021. Fertilisation : la disponibilité de l’azote dans le sol [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.paysansdelaloire.fr/articles/22/03/2021/Fertilisation-la-disponibilite-de-l-a%20zote-dans-le-sol-53946/
- CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE, 2022. Les avantages des couverts végétaux [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/les-avantages-des-couverts-vegetaux/#:~:text=Les%20couverts%20v%C3%A9g%C3%A9taux%20sont%20g%C3%A9n%C3%A9ralement,%2C%20le%20pois%2C%20la%20f%C3%A9verole.
- N'DAYEGAMIYE A., 2007. La contribution en azote du sol reliée à la minéralisation de la MO : facteur climatique et régies agricoles influençant les taux de minéralisation d'azote [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/NDayegamiye_A_resume_PPT.pdf
- RECOUS S., CHABBI A., VERTès F., 2020. Fertilité des sols et minéralisation de l’azote : sous l’influence des pratiques culturales, quels processus et interactions sont impliqués ? [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://hal.science/hal-01589707/file/F223-Recous_2.pdf
- UNIFA, 2013. Le cycle de l’azote (N) [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://fertilisation-edu.fr/cycles-bio-geo-chimiques/le-cycle-de-l-azote-n.html
- Y.STEIN L., G.KLOTZ M., 2016.
The nitrogen cycle [en ligne]. Disponible à l'adresse :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982215015183